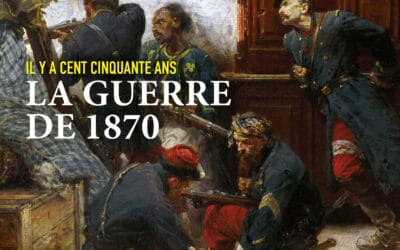Récit de sa belle-sœur Antoinette Gamot.
7 décembre 1815
Le jour du jugement, je restai près de ma sœur ; nous attendions à chaque instant
des nouvelles. La séance se prolongea fort tard ; à deux heures du matin, rien ne nous était parvenu. J’engageai ma sœur à se coucher, je sentais que ses forces allaient lui devenir bien nécessaires. On me dressa un lit près du sien.
Entre quatre et cinq heures, nous entendîmes frapper avec violence ; notre effroi fut extrême. Ma pauvre sœur ne savait si on lui apportait la mort ou la vie de son mari. On venait la chercher de sa part ; il la demandait à l’instant. Habillées à la hâte, nous montâmes en voiture. La nuit était obscure, le plus grand calme régnait dans Paris. Arrivées près du Luxembourg, nous rencontrâmes plusieurs patrouilles à cheval qui marchaient au pas, seul bruit qui se faisait entendre dans les rues sombres et désertes ; je vis des casques, les uniformes étaient cachés sous des manteaux. La voiture s’arrêta, la porte du Luxembourg s’ouvrit en criant sur ses gonds : ce bruit qui me fit battre le cœur retentit encore à mon oreille.
Descendus au fond de la cour, on nous fit monter par un escalier long et étroit qui mène à un pavillon très élevé. Dans une petite antichambre se pressait une foule de gardes ; l’émotion qui m’oppressait m’empêcha de reconnaître l’uniforme. Une porte s’ouvrit et nous entrâmes dans une pièce d’une assez noble apparence dont les fenêtres fermées placées au-dessus de l’architecture cintrée qui régnait autour de la chambre ne donnaient le jour que du haut.
Le Maréchal s’éveilla à notre arrivée ; se levant du lit où il était couché tout habillé, il vint au-devant de sa femme, la prit dans ses bras, l’assit sur ses genoux, cherchant à lui donner des consolations que ses larmes et ses sanglots l’empêchaient peut-être d’entendre : « Mon amie, calme-toi, lui disait-il ; tu le vois, mon âme est tranquille ; j’ai dormi quelques heures sans que rien ne troublât mon repos. Tu as déjà pleuré ta sœur, ton père1 ! Pauvre femme, disait-il en s’attendrissant, tu as déjà bien souffert, mais tu as supporté tes malheurs avec courage, tu supporteras ma mort pour te conserver à tes enfants. Tu dois les élever, les rendre dignes de toi ».
Puis il la plaça dans un fauteuil et il se promenait dans la chambre sans la moindre agitation et parlait avec sang-froid de sa position : « Nouveau Curtius, disait- il, je me suis précipité pour sauver ma patrie ». Puis il parla de son jugement, de la séance dans laquelle il venait d’être condamné : « J’avais jugé, disait-il, en entendant le réquisitoire du procureur général qu’elle serait la décision de la Chambre ». Il dit ensuite comment ses avocats avaient reçu un paquet cacheté dans lequel était défendu de plaider sur la capitulation.
J’admirais ce calme, cette grandeur d’âme qui le faisait parler sans émotion, sans la moindre indignation, de l’affreuse injustice qui le livrait à la mort, et du discours féroce de ce procureur du Roi qui demandait à grands cris le sang qui était habitué à couler pour la Patrie. Ma sœur dans son désespoir s’écria : « Ah ! tu seras vengé ! – Non mon amie, lui dit-il avec force, non, tu apprendras à tes enfants à pardonner, tu le leur diras de la part de leur père ». Puis il disait : « Qu’est-ce que la mort, mon amie ? Combien de fois ne l’ai- je pas vue sur les champs de bataille ! Crois-moi, elle n’a rien d’effrayant. Ne pouvait-elle alors nous séparer ? Et que sont dix ans, vingt ans de plus, de moins, dans la vie ! ».
Comme il m’aperçut à genoux dans un coin de la chambre où je priais Dieu d’abaisser un regard sur cette scène de douleurs : « On m’a amené, dit-il, le curé de Saint-Sulpice ; c’est un brave homme, j’ai été bien aise de le voir. Je lui ai dit : je n’ai pas oublié la religion de mes pères, ni les sentiments qui m’ont été inspirés dans mon enfance. Monsieur, lui ai-je dit, jamais sur le champ de bataille, je n’ai manqué d’élever mon âme vers Dieu ; j’espère en sa bonté ». Puis il demanda ses enfants ; on envoya à l’hôtel pour les chercher. « Il y a aujourd’hui vingt ans, dit-il à ma sœur, que je suis entré dans l’état militaire ; dois-je te conseiller de le faire embrasser à mes enfants ? Quelle responsabilité, le bien de la Patrie ! J’ai écrit à ma sœur, me dit-il, pour lui dire d’adoucir la nouvelle à mon respectable père ; il est bien vieux, les ménagements lui sont nécessaires. Priez Gamot de la faire passer sûrement à ma sœur ; ce sera la dernière de tant de marques d’amitié qu’il m’a données ».
En marchant, il passait devant la porte surmontée d’une espèce de guichet auquel était collée sans cesse la figure d’un des gardes qui le surveillaient avec la plus grande indifférence. Ce fut le sujet du seul mouvement d’indignation que lui ai vu :
« Il est cruel, dit-il, de ne pouvoir être seuls en de semblables instants ». Ses enfants arrivèrent : les trois aînés, on n’avait pas voulu réveiller le dernier âgé de quatre ans. Il les embrassa en leur recommandant d’aimer, de respecter leur mère.
Ma sœur lui avait dit au milieu de ses sanglots qu’elle obtiendrait la grâce, qu’elle irait la demander jusqu’aux pieds du Roi, que tous ses amis étaient persuadés que son intention était de l’accorder. Le maréchal qui avait écouté cette assurance avec indifférence profita d’une persuasion, que je vis qu’il ne partageait pas, pour éloigner sa famille et mettre fin à la scène déchirante que sa grande âme ne pouvait supporter. Et regardant à sa montre :
« Puisque tu veux faire cette démarche, mon amie, il est temps de partir ».
Ma malheureuse sœur, malgré son espérance, était dans l’état le plus affreux et n’avait pas la force de s’arracher de ses bras. Il se tourna vers moi et me dit : « Madame, ayez soin de votre sœur ». Des larmes coulèrent sur ses joues, les premières que je lui eusse jamais vu verser. J’entraînai ma sœur et la ramenai à son hôtel où je la laissai avec ses enfants. J’allai sur le champ chez M. de Lally qui était ami de ma tante4 ; il avait souffert de l’injustice des hommes, j’espérai qu’il accompagnerait la maréchale chez le Roi. On l’éveilla pour m’introduire chez lui. Il me reçut avec affection et intérêt ; il me nomma plusieurs maréchaux qui, plus convenablement, pourraient me rendre service.
Je le quittai et trouvai M. Gamot près de ma sœur. Il était au désespoir : on lui avait refusé l’entrée du Luxembourg. Il fallait trouver quelqu’un pour conduire aux Tuileries ces malheureux suppliants. Je parlai du duc de Raguse et on me dit qu’il avait voté la mort. J’indiquai plusieurs autres : c’était impossible. Alibert dont l’amitié l’avait amené près de nous, alla chez quelques personnes et fut refusé partout. On nous dit que nous ne devions pas tarder davantage. Je me décidai à ne point la laisser seule et l’accompagnai à ce Palais où le refus le plus outrageant et le coup le plus cruel devaient être portés à la femme du héros auquel des armées de Français avaient dû leur gloire et leur salut. Arrivée au pied de l’escalier du pavillon de Flore, on lui refusa le passage ; nos supplications étaient inutiles. Aucun des valets assis sur les banquettes n’osait se charger de la conduire et elle restait debout au milieu de ces hommes plus attendris de la vue de cette famille éplorée que ceux qui lui devaient leur secours. Un exempt des gardes vint dire à ma sœur qu’il était impossible qu’elle vît le Roi, que cela pourrait troubler son déjeuner : des corbeilles de viandes qui passaient près de nous montraient que c’était l’heure du repas de Sa Majesté. Dans cet instant, un homme que je ne connaissais pas descendit
Enfin au bout d’un quart d’heure, on fit dire à ma sœur qu’elle pouvait monter. On la conduisit chez un capitaine des gardes, puis chez M. de Duras.
Là, ma sœur le suppliait ainsi que sa femme de l’introduire chez le Roi, lorsqu’il vînt me dire à l’oreille : « Il n’est plus temps. Emmenez-la ». Je ne dirai point tout ce que me fit éprouver ce mot qui résonne encore au fond de mon cœur. Je recueillis toute ma force pour ne m’occuper que de ma malheureuse sœur.
« Viens, lui dis-je avec l’indignation douloureuse que je m’efforçais de réprimer, viens, ce n’est pas ici ta place » et je prenais sa main pour l’entraîner. Mais ce mot lui découvrit toute l’horrible vérité : elle tomba sur le plancher presque sans connaissance et dans un état que je ne peux décrire. Ramenée à elle, elle voulait fuir ; deux personnes la soutinrent, on la mit dans sa voiture où elle s’abandonna au désespoir et aux cris les plus douloureux ; ses pauvres enfants y répondaient par des gémissements.
Quelle scène, grand Dieu ! Que ne s’est-elle effacée de mon cœur !